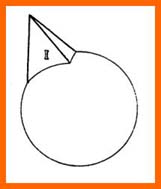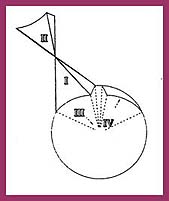A travers les symboles du cercle,
du trois, du triangle pointe en haut (ciel, esprit, haut...), et ceux
du triangle pointe en bas, du quatre, et du carré (terre, matière,
bas...), "Chromophonie
Scriptorale" privilégie donc, dans la démarche
créatrice, une relation verticalo-horizontale, en rapport avec
le centre d'inspiration, relation à double sens dans les deux
directions, qui est au coeur de la musique. Elle n'est donc pas étonnante
de la part du peintre-musicien qu'est Yochk'o Seffer, puisqu'intimement
liée à son expérience créatrice.
Horizontalité et verticalité, carrés, rectangles,
angles (sinon triangles) s'opposant, courbes et cercles font, en effet,
partie intégrante de l'écriture musicale, qu'il s'agisse
de mise en place rythmique où la pulsation binaire ou ternaire
doit tourner, de technique instrumentale, de notation ou encore de
composition, cette dernière est notamment fondée sur
un bon rapport entre la mélodie horizontale, davantage liée
à la sensibilité, et l'harmonie verticale faisant plus
appel au raisonnement, comme le notait Grétry il y a deux siècles.
(L'écriture mélodique "en écrevisse"
qui redonne un thème à l'envers, et les renversements
d'accords harmoniques, sont deux exemples de double sens horizontalo-vertical
dans la composition.)
Mais, en signifiant picturalement la complémentarité
verticalo-horizontale par un jeu de transpositions (branches-ressorts
de la pince - regards du couple etc...), c'est au jeu des saxophones
que le saxophoniste Yochk'o Seffer fait plus particulièrement
penser. Car, en dehors du fait que ces instruments transpositeurs
en mi b et en si b, amènent à une lecture horizontale
souvent déplacée verticalement, ils associent l'horizontal
au vertical ascendant et descendant dans la forme de leurs tubes,
ce qui suppose une conception du souffle adaptée à ces
deux directions, conception demandant une transposition mentale, quand
il s'agit de jouer successivement (parfois simultanément !)
les soprani ou sopranini au toucher quasi horizontal, et d'autres
membres de la famille au toucher quasi vertical. La recherche sonore
est, dans tous les cas, de rondeur, adaptée à la section
du tube de l'instrument, se développant longitudinalement et
côniquement dans le sens de l'ouverture, du bec au pavillon.
Elle fait tourner dans l'abdomen, dans la bouche, entre les doigts
et le tube, l'énergie du musicien, à la vitesse de la
pulsation, dans des plans horizontaux et verticaux croisés.
Comme pour la musique, où les deux directions de la croix correspondent
à des caractéristiques spirituelles de sensibilité
et de raisonnement, les données physiques du jeu des saxophones
ont pour correspondance une distinction entre les esprits d'improvisation
et de composition-interprétation, privilégiant respectivement
le foisonnement horizontal et la transcendance verticale. Cela ne
signifie pas que l'improvisateur n'a aucun sens de la construction
verticale, alors que son jeu est très axé sur l'harmonie,
mais que ses constructions, moins élaborées que celles
des compositeurs sur ce plan, s'élèvent moins haut.
(En Casamance, les sénégalais de tradition orale, origine
de la tradition improvisée, construisent en banco des cases
à étage, entendez : à un étage, ce qui
témoigne d'une volonté d'élévation verticale
embryonnaire, mais incapable, sans la filtration "scripte"
d'aboutir aux gratte-ciel américains, et encore moins aux fusées
partant vers d'autres planètes !) Les saxophonistes interprètes
jouent, quant à eux, une ligne mélodique horizontale,
où l'élévation est dans l'épuration du
style et du son, jusqu'à une plénitude quasi céleste,
qui n'a rien à voir avec le jaillissement quasi "tripal"
de l'improvisateur (VII
6). Les mélomanes amateurs de saxophone font très
bien la différence, ils préfèrent l'un des deux
styles, montrant ainsi leurs affinités spirituelles, mais sont
généralement totalement incapables de comprendre que
des saxophonistes interprètes ou improvisateurs soient très
difficilement interchangeables pour leur donner le jeu qu'ils aiment,
dans lequel ils se reconnaissent.
Appartenant autant aux compositeurs qu'aux improvisateurs, le saxophone
est, en effet, le lieu même de la contradiction, à laquelle
il trouve une issue musicale de synthèse. C'est l'instrument
d'un conflit que la société occidentale vit très
mal, car cette opposition d'esprit y est tout aussi présente,
sans qu'elle parvienne à en saisir la nature profonde, et encore
moins à en tirer parti : nous avons déjà vu,
dans "Chromophonie Scriptorale",
que l'horizontalité de la foi islamique se replaçant
au niveau de l'homme et du sol s'oppose au pouvoir de filtration "scripte" de la foi judéo-chrétienne, aboutissant notamment à
l'Ascension du Christ. Mais, cette opposition ne s'en tient pas là,
elle vise également le développement technique débouchant
sur la conquête spatiale que cette foi a engendré : si
nous considérons l'actualité récente (en 1991,
N.D.L.R.) de la (Première, N.D.L.R.) Guerre du Golfe à
partir de l'improvisation VIII
5 ("ISLAM,
FOI EN NOUVEL ORAL"),
nous observons sur cette dernière un énorme supersonique
au nombre 35 (3 + 5 = 8, symbole d'infini) qui en domine un autre
plus petit et crucifié. Le tableau a été réalisé
plus d'un an avant le conflit qui a précisément donné
l'image de l'opposition verticalo-horizontale des compositeurs-interprètes
et des improvisateurs. Les premiers représentent les forces
de la Coalition avec la suprématie américaine, et un
lien puissant entre les U.S.A. et Israël : ils se sont élevés
à dix mille mètres pour faire une guerre de "vidéogames"
et du "Meilleur des Mondes". Les seconds sont les irakiens
dont l'aviation, clouée au sol, n'a pas pu décoller.
Ils ont contré l'ascension ennemie par la descente sous terre
et le déplacement au sol en caravane de leur chef, et ont mené
une guerre psychologique dite "de la foi contre la technique",
de l'"oral" contre le
"script", où
la foi en question s'est révélée être dans
le pouvoir du verbe humain, trouvant son inspiration, comme les improvisateurs
version Seffer, dans la contradiciton des initiatives adverses, au
terme de laquelle ils ont allumé le feu de la terre avec les
puits de pétrole, déclenchant ainsi un début
de catastrophe écologique aux conséquences planétaires,
dont la haute technologie américaine fut si en peine de venir
à bout qu'elle dut recourir à des engins... improvisés
(!) par les pays de l'Est pour les éteindre, comme si, seule
l'improvisation pouvait vaincre l'improvisation. On mesure l'importance
du danger, si, au lieu du petit état irakien, tout le pouvoir
improvisateur se liguait contre le pouvoir de composition-interprétation
! Et l'on remarque que ce feu de la terre s'élevant contre
le feu artificiel du ciel, mis en oeuvre par la Coalition, correspond
symboliquement tout à fait au schéma ci-dessus (cf. #imp) - voir aussi Irak - Kosovo
-11 Septembre 2001 - Irak , et les actuels bourbiers irakien et
palestinien, N.D.L.R. du 11 Août 2004)..
Il y a donc, là, une terrible démonstration du pouvoir
de la démarche improvisatrice, et de l'importance de l'enjeu "scriptoral" : entre
les compositeurs-interprètes et les improvisateurs, il y a
deux possibilités : la première, c'est la guerre, avec,
à terme, la destruction de la planète où les
"vainqueurs" seront au moins aussi perdants que les "vaincus",
la seconde, c'est la création, débouchant sur la lumière
et la paix, ce qui suppose d'entrer en guerre, non plus contre les
autres, mais contre soi-même et ses habitudes de pensée,
pour co-naître.
Si les esprits de composition et d'improvisation opposent les artistes
entre eux, sur les plans de l'ascension verticale et de l'ouverture
horizontale, il n'en reste pas moins que l'art, dans son ensemble,
est plus axé sur la sensibilité, la communication avec
le public, et donc l'horizontalité. Il est d'ailleurs loin
d'avoir fait le tour de la terre, c'est à dire la synthèse
de tous les courants qui l'animent, permettant une expression universelle
de l'humanité. La science, par contre, dont les sondes fouillent
l'espace, et qui fait davantage place à l'intelligence qu'à
la sensibilité (témoins les paisibles inventeurs d'armes
terrifiantes), est, elle, plus axée sur la verticalité.
On retrouve donc, dans le domaine de la connaissance, entre l'art
et la science, l'opposition de l'horizontal et du vertical, mais on
est en train, là aussi semble-t-il, de découvrir la
complémentarité des deux éléments en présence
: Dans un article du "Figaro Magazine" du 1er Décembre
1990, à propos du livre de Marcel Odier, "L'Esprit de
la nouvelle Science" (Editions l'Age d'Homme), Jean-Luc Nothias
récapitule les grandes étapes de la Physique fondamentale.
Et les découvertes qu'il cite corroborent l'idée d'une
correspondance entre le processus spirituel, tel que l'artiste le
vit intérieurement, et le développement de l'univers,
tel que le saisit "l'esprit de la nouvelle science". Citons,
par exemple : "la mécanique ondulatoire" de Louis
de Broglie, en 1925, associant la théorie des ondes à
celle des corpuscules (la lumière se propage comme une onde
et se constate comme un corpuscule : le photon) ; l'anti-matière
(Dirac, 1930) ; la descente dans l'atome synonyme d'une remontée
à l'origine de l'univers à l'aide des "pions"
(1948) ;la possibilité de suppression du temps ou d'inversion
de son fléchage (Costa de Beauregard, 1953) ; la non-séparatibilité
selon laquelle deux évènements sans relation dans le
présent, peuvent être liés soit par le passé,
soit par le futur (John Belle, 1964, Alain Aspect, 1982). Non-séparatibilité
de l'espace-temps et du passé-présent-futur, avec exacte
symétrie passé-futur ; interaction matière-esprit...
N'est-ce pas précisément la réconciliation s'opérant
dans nos têtes entre matière et esprit, qui rend possible
l'entrée dans un temps de synthèse, de complémentarité
des contradictions, où les scientifiques expliquent ce que
sentent les artistes, et où les artistes sentent ce qu'expliquent
les scientifiques. La convergence des connaissances subjective et
objective, enfin réconciliées ! menant alors ces deux
catégories de chercheurs à marcher, la main dans la
main, vers la communion de l'intérieur et de l'extérieur,
et l'unité de l'être qui en découle ?
L'interaction matière-esprit, à travers l'opposition
symétrique de la composition et de la destruction improvisatrice
et la réorientation abaissée de l'interprétation
dans la transformation improvisatrice, c'est précisément
ce que vit la création artistique, dans son ensemble, et chacun
de ses acteurs, en particulier, s'il ne veut pas se laisser enfermer
dans le carcan d'une composition, d'une interprétation, d'une
improvisation stéréotypées. Il n'y a de création
que dans cette interaction. Jean-Luc Nothias remarquant, à
la suite de Costa de Beauregard, qu'au niveau des particules, le temps
peut ne pas exister, ou agir "à l'envers", et que
cela pourrait se retrouver au niveau de l'esprit et des phénomènes
psychologiques, dès lors, la collision du monde de l'improvisation
avec celui de la composition-interprétation, visant à
désintégrer la forme pour retrouver l'esprit et lui
donner une nouvelle forme, ne donne-t-elle pas, à l'échelle
humaine, c'est à dire à une vitesse extrêmement
lente, une image des collisions électrons-positrons, à
des vitesses avoisinant celle de la lumière dans le LEP ("Large
Electron Positron Collider") ? Cette collision n'est-elle pas
aussi celle des artistes et des scientifiques, les uns trouvant la
matière dans l'esprit et les autres l'esprit dans la matière,
collision de la sensibilité et du raisonnement, de l'amour
et de l'intelligence (cf. X 4,
X 5, X 6)
?
Au niveau symbolique, l'esprit est signifié par le cercle et
le triangle pointe en haut, et la matière par le triangle pointe
en bas et le carré. C'est à dire qu'à notre interprétation
graphique unissant à terme en tous sens carrés et triangles,
il manque le cercle entourant les triangles d'une même pyramide
sur toute leur hauteur, et le cercle entouré par ces triangles
sur toute leur hauteur, autrement dit, le cône, contenant la
pyramide pour exprimer la création artistique, et contenu par
elle pour évoquer la recherche scientifique, à l'intérieur
duquel pourrait se trouver une autre pyramide, et ainsi de suite dans
les deux sens... le premier de tous les cônes étant le
cône-essence du monde, l'alpha, alors que l'oméga, c'est
à dire l'enchaînement cônes-pyramides figurerait
la co-naissance...
Mais au fait, qu'évoque le cône pour un saxophoniste
?...