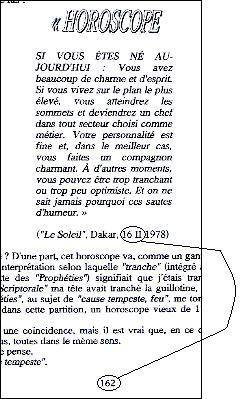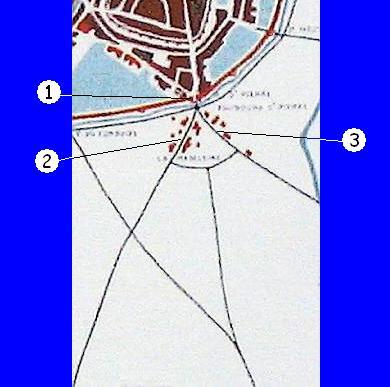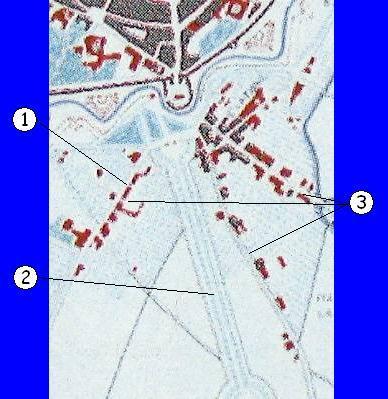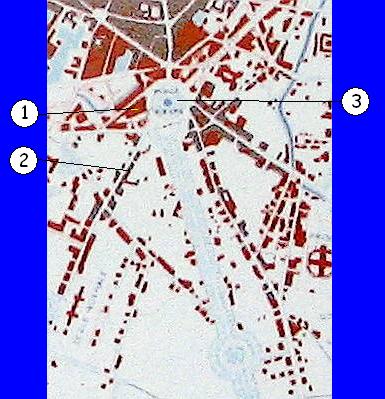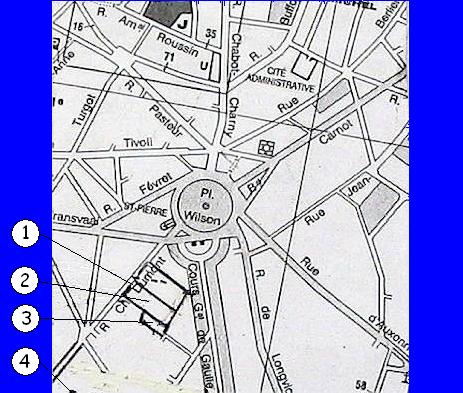|
|
Cherchant, en Mars 2000,
un livre, dans une librairie de Dijon, Y en trouva un autre, contenant des renseignements qu'il attendait depuis
3 ans : "Dijon Histoire Urbaine", publié par ICOVIL,
avec tous les plans de l'évolution de la ville, de ses origines
à l'an 2000, via les XIVème, XVIème, XVIIIème,
XIXème siècles et l'an 1949, de sa naissance.
Et là, nouvelle surprise :
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
AU XIVème SIECLE
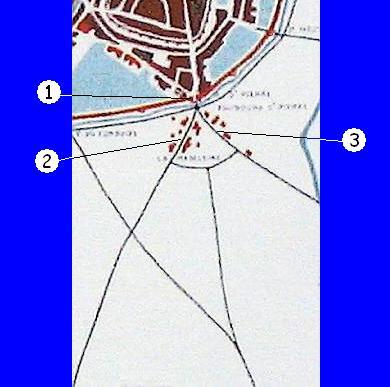
1.- Porte Saint-Pierre, devant l'ancienne Eglise Saint-Pierre.
2.- Faubourg de la Magdeleine avec
Commanderies des templiers et des Hospitaliers de Saint Jean
de Jérusalem,
et chapelles Saint-André (des templiers) et Sainte-Magdeleine
(des Hospitaliers).
3.- Faubourg Saint-Pierre, actuelle rue d'Auxonne.
|
|
A la porte Saint-Pierre de Dijon,
faubourg de la Magdeleine, voué à Saint Jean,
et Faubourg Saint-Pierre.
(Extrait de plan de "Dijon Histoire Urbaine"-
Editions ICOVIL -.)
|
|
A la fin du XIVème siècle, le rempart de la ville, qui
suivait le trajet de l'actuelle rue de Tivoli, arrivait devant l'ancienne
Eglise Saint-Pierre
aujourd'hui disparue, à la porte Saint-Pierre, située
à l'emplacement des actuels (2004) premiers feux de signalisation
de la rue Chabot-Charny, à partir de l'actuelle Place Wilson.
A l'extérieur, un fossé rempli d'eau, après quoi
se trouvaient deux faubourgs, allant de ces feux de signalisation
jusqu'à l'entrée de l'actuel cours du Général
de Gaulle (auparavant cours du Parc), et recouvrant notamment, l'actuelle
place Wilson (auparavant nommée place Saint-Pierre).
Les deux faubourgs partaient donc de la porte Saint-Pierre, avec :
|
 le
faubourg Saint-Pierre en direction sud-sud-est, construit le long
de l'actuelle rue d'Auxonne, le
faubourg Saint-Pierre en direction sud-sud-est, construit le long
de l'actuelle rue d'Auxonne,
 le
faubourg de la Magdeleine, en direction sud-sud-ouest, puis plein
sud, comprenant la commanderie des Templiers avec sa chapelle
Saint-André, donnée par Philippe le Bel aux Hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem, dont la commanderie et la chapelle
Sainte-Magdeleine se trouvaient en face, l'ordre du Temple supprimé
étant donc voué à Saint Jean, comme son héritier
subsistant. le
faubourg de la Magdeleine, en direction sud-sud-ouest, puis plein
sud, comprenant la commanderie des Templiers avec sa chapelle
Saint-André, donnée par Philippe le Bel aux Hospitaliers
de Saint Jean de Jérusalem, dont la commanderie et la chapelle
Sainte-Magdeleine se trouvaient en face, l'ordre du Temple supprimé
étant donc voué à Saint Jean, comme son héritier
subsistant.
|
Ces
deux rues étaient reliées par une transversale, au
niveau de l'actuel début du Cours du Général
de Gaulle. Au milieu de cette transversale, déjà en
arc de cercle, partait une rue qui était dans l'axe des actuelles
allées du Parc. La rue de Longvic, partant du début
de cet axe pour le longer à l'est, n'existait pas au XIVème
siècle. Ces deux faubourgs situés le long des rues
du Temple et d'Auxonne, formaient donc, avec leur transversale arquée,
un triangle, à la base arquée par le fait de la transversale,
après laquelle il n'y avait plus de construction, à
l'exception d'une bâtisse, le long de la rue d'Auxonne, et
des deux moulins Saint-Etienne et Bernard (trop bas pour figurer
sur le plan ci-dessus), sur l'Ouche, longeant la rue du Temple (Charles
Dumont - des Moulins actuelles), ce qui lui donnera son nom intermédiaire
de rue des Moulins, qu'elle a gardé au bas de l'actuelle
rue Charles Dumont.
Ces deux faubourgs réunissaient donc Pierre, à l'Est,
et Jean, à l'Ouest, le "bon" et le "mauvais",
pourrait-on dire, le "bon" étant celui des Hospitaliers,
et le "mauvais", aux yeux du pouvoir royal (plus que papal),
puisque démantelé, étant celui des Templiers.
Le problème est de savoir, si c'est ce que les disciples
de Jean ont fait de ces ordres, qui est "bon ou mauvais",
ou si c'est la spiritualité johannique, qui est seulement
en partie acceptée par le roi et le pape, ceux-ci rejetant
comme "mauvaise" une autre partie qui leur échappe
spirituellement.
Or, nous avons vu que les Templiers anticipaient les cavaliers blancs
de l'"Apocalypse", et que l'Apocalypse" était
source d'une rivalité entre Pierre et Jean ("le disciple
que Jésus aimait"), sur les plans de l'amour du Christ,
précisément, et aussi de la mort et de la pérennité,
si ce n'est corporelle, du moins spirituelle (cf. #amo),
l'Eglise de Pierre s'associant par ailleurs, peut-être un
peu trop vite
au Christ,
au regard de ses écarts de conduite, dans le Roi des rois
de l'"Apocalypse" de Jean.
A partir de là, il est très intéressant de
regarder l'évolution géographique de Pierre et de
Jean, à la porte Saint-Pierre de Dijon, le premier étant
à l'origine, à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur des murs, quand le second était
seulement exposé aux exactions extérieures. C'est
ainsi qu'en 1513, les Suisses incendièrent les deux commanderies
et chapelles du faubourg de la Magdeleine, qui seront détruites
par les Dijonnais dès 1516, de sorte que le plan du milieu
du XVIème siècle nous montre un bastion Saint-Pierre
avançant désormais en arrondi jusqu'au milieu de l'actuelle
place Wilson, entouré d'eau, en face duquel se développent
de nouvelles constructions constituant le faubourg Saint-Pierre,
le long de l'actuelle rue d'Auxonne et d'un embryon de l'actuelle
rue de Longvic, tandis que le faubourg de la Magdeleine a disparu
le long de la rue du Temple, vide de toute bâtisse.
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
AU MILIEU DU XVIème SIECLE

1.- Quartier de la Magdeleine.
2.- Ancienne Eglise Saint-Pierre.
3.- Porte et bastion Saint-Pierre.
4.-
Pont-levis.
5.- Faubourg de la Magdeleine, rue du Temple, rasé
en 1516.
6.-
Faubourg se développant sur les actuelles rues de
Longvic et d'Auxonne.
|
|
Disparition
du faubourg de la Magdeleine,
développement du faubourg Saint-Pierre,
avancée du bastion Saint-Pierre.
(Extrait
de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL
-.)
|
|
Un
pont-levis donne toutefois encore du bastion sur cette rue du Temple,
pont-levis qui semble disparaître sur le plan de la fin du XVIIIème
siècle, et être remplacé par une poterne, à
la jonction du bastion et du rempart. Mais, dès lors, la rue
du Temple (ou déjà, des Moulins ?) ne va plus jusqu'au bastion, elle s'arrête, comme l'actuelle
rue Charles Dumont, au niveau de l'actuelle rue du Transvaal.
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
A LA FIN DU XVIIIème SIECLE
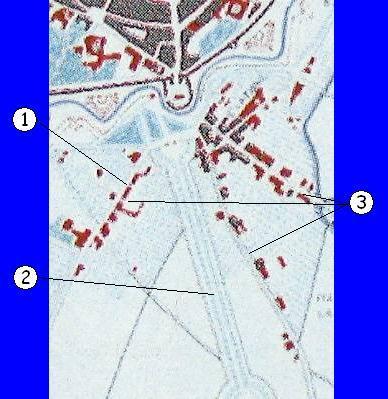
1.- Rue des Moulins
(anciennement du Temple, et, ensuite, Charles Dumont, en haut,
repoussée au début du nouveau Cours du Parc).
2.- Cours du Parc de la Colombière.
3.- Faubourg Saint-Pierre sur actuelles rues d'Auxonne et
de Longvic,
ainsi que sur la rue des Moulins (rues Charles Dumont + des
Moulins actuelles).
|
|
Le
faubourg Saint-Pierre couvre aussi l'ancienne rue des Moulins,
repoussée au début du nouveau Cours du Parc
de la Colombière
(Extrait
de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL
-.)
|
|
Ainsi, dès le XVIème siècle, la commanderie des
Hospitaliers et sa chapelle Sainte-Magdeleine, entrèrent dans
les murs de la ville, formant le quartier Sainte-Magdeleine, tandis
qu'apparemment, selon Y,
disparurent la commanderie des Templiers et sa chapelle Saint-André.
Selon
les signes de Y, en effet, les apparences qui donnent tout l'espace à Saint-Pierre,
et qui ont fait disparaître Jean à travers Saint-André
et Sainte-Magdeleine, sont trompeuses.
En effet, l'avancée Saint-Pierre se poursuivit au XIXème
siècle : le fossé fut comblé, le bastion Saint-Pierre
s'élargit en place Saint-Pierre (l'actuelle place Wilson),
qui s'étendit jusqu'à l'entrée du cours du Parc
(cours Général de Gaulle), et sur laquelle fut construite
l'actuelle Eglise Saint-Pierre, Eglise de la paroisse de Y,
avançant de 200 mètres, par rapport à l'ancienne,
et se trouvant, désormais, hors des anciens murs.
L'Eglise et la place Saint-Pierre
sont en fait situées à
l'emplacement du faubourg de la Madeleine, et donc des commanderies
du Temple et des Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, avec
leurs chapelles Saint-André et Sainte-Magdeleine, Sainte-Magdeleine
étant entrée dans les anciens murs de la ville, alors
que la chapelle Saint-André des Templiers fut totalement recouverte
par Saint-Pierre, paroisse de Y.
Et, à l'exception d'un pan de mur du quartier de la Magdeleine,
il ne reste maintenant plus rien des deux commanderies et de leurs
chapelles tant dans les anciens murs de la ville, qu'à l'extérieur.
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
A LA FIN DU XIXème SIECLE
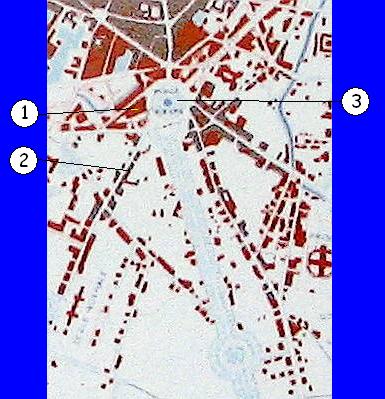
1.- Nouvelle Eglise Saint-Pierre.
2.- Pharmacie André (1897)
3.- Place Saint-Pierre.
|
|
Construction
de l'Eglise et de la place Saint-Pierre,
sur le bastion Saint-Pierre rasé,
et étendu jusqu'au Cours du Parc de la Colombière.
(Extrait
de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL
-.)
|
|
Toutefois,
le premier élément qui étonna Y,
c'est que, dans ses dix premières années, le prêtre
de l'Eglise Saint-Pierre lui fit penser, par l'élancement
de son verbe, à Jean, non à Pierre, et le conduisit
au "disciple que Jésus aimait". Sachant maintenant
que le Père Latour évoluait sur les lieux de la spiritualité
johannique des templiers, il a le sentiment que cette spiritualité
sourdait des pavés de l'Eglise de Pierre.
Mais ce n'est pas tout : dans la rue anciennement du Temple (Charles
Dumont actuelle) est apparue, depuis 1897, la Pharmacie André,
du nom de la chapelle de la commanderie des Templiers. Et, la place
Saint-Pierre (actuelle place Wilson), ayant repoussé la rue
anciennement du Temple de sa profondeur, depuis le carrefour Chabot-Charny
- Tivoli, jusqu'à la rue du Transvaal, la Pharmacie André
se retrouve à peu près, par rapport à la nouvelle
Eglise Saint-Pierre, à l'endroit où la chapelle Saint-André
se trouvait au XIVème siècle, par rapport à
l'ancienne Eglise Saint-Pierre, derrière la porte Saint-Pierre
: environ 150 à 200 mètres.
Tout s'est passé donc comme si la spiritualité johannique
templière avait survécu sur les lieux investis par
Pierre, et comme si sa chapelle était réapparue sous
la forme de la Pharmacie André, soignant le corps en place
de l'esprit. Il convient de remarquer que c'est la devanture réalisée
par cette pharmacie à l'occasion de son centenaire, en 1997,
qui révéla à Y l'histoire de ce quartier, ignorée de la quasi totalité
des Dijonnais, au moment où lui-même se demandait quel
était le sens de son séjour rue Charles Dumont (rue du Temple) de 1961 à 1971, entre son séjour rue
Mozart (1949-1961) (cf. auteur.htm#moz
et auteur.htm#tem) et son séjour
à Eragny (à partir de 1980) (cf. 43_alpha_apex_omega.htm#era)
: ses deux derniers étaient fortement significatifs pour
lui, alors que la rue Charles Dumont ne lui disait rien, jusque
là. Or, il avait relié Mozart à Marie-Antoinette,
Louis XVI et au Temple (cf. interpretation.htm#temple),
et voilà que la Pharmacie André lui apprenait, que
la rue Charles Dumont était précisément la
rue du Temple à Dijon, et cela, parce que,
|
 d'une
part, il se trouvait, par
asar, à Dijon à ce
moment là,
d'une
part, il se trouvait, par
asar, à Dijon à ce
moment là,
 et,
d'autre part, son père lui avait demandé, comme
un service, de regarder cette devanture, pour y trouver de l'inspiration
pour inscrire une phrase dans le Livre d'Or de cette pharmacie,
ouvert à tous ses clients à l'occasion de son centenaire...
et,
d'autre part, son père lui avait demandé, comme
un service, de regarder cette devanture, pour y trouver de l'inspiration
pour inscrire une phrase dans le Livre d'Or de cette pharmacie,
ouvert à tous ses clients à l'occasion de son centenaire...
|
Il y a donc bien là une véritable conduite menant Y,
via la Pharmacie André, aux origines de sa rue et au remplacement
de la commanderie des Templiers et de sa chapelle Saint-André
par l'Eglise Saint-Pierre.
Ajoutons à cela que, durant 10 ans, Y habitera avec ses parents dans la cour de la Pharmacie André,
et que sa mère a pour prénom : Andrée, le
nom féminisé de cette dernière et de la chapelle
des Templiers.
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
EN 1949

1.- Rue
Mozart, où Y
passa ses 12 premières années.
2.- Pharmacie
André devant son terrain qui sera triplement divisé.
|
L'année
de naissance de Y,
terrain de la Pharmacie André
qui sera triplement divisé par la suite
(Extrait
de plan de "Dijon Histoire Urbaine"- Editions ICOVIL
-.)
|
|
Mais cela va encore plus loin, car il y a également dans le
livre sur Dijon, un plan de la ville en 1949, année de la naissance
de Y,
Et là, la cour de la Pharmacie André, où sont
les 3 immeubles du 13, ne fait qu'un avec les deux parcelles qui l'entourent,
où se trouvent :
|
 du
côté de l'Eglise Saint-Pierre, un groupe d'immeubles
plus ancien dépendant également de cette même
paroisse Saint-Pierre, du
côté de l'Eglise Saint-Pierre, un groupe d'immeubles
plus ancien dépendant également de cette même
paroisse Saint-Pierre,
 au centre,
les immeubles du 13, au centre,
les immeubles du 13,
 et de
l'autre côté... la Mosquée
de Dijon ! et de
l'autre côté... la Mosquée
de Dijon !
|
Ainsi,
à l'image de la nouvelle forme de spiritualité liée
à l'islam, que les templiers voulurent développer en
Orient, et qu'ils exprimèrent entre autres dans le Baphomet
(cf. 384_suite.htm#imp), la Pharmacie
André, symbole selon les signes de Y, de la chapelle Saint-André de la commanderie des Templiers,
et donc symbole de la spiritualité templière,
a réuni, en haut de la rue anciennement du Temple (rue Charles
Dumont actuelle), |
.gif) la spiritualité de l'Eglise romaine
(paroisse Saint-Pierre),
la spiritualité de l'Eglise romaine
(paroisse Saint-Pierre),
.gif) l'héritier royal, à la spiritualité
johannique (Y,
selon ses signes), l'héritier royal, à la spiritualité
johannique (Y,
selon ses signes),
.gif) et l'islam (la Mosquée de Dijon).
et l'islam (la Mosquée de Dijon).
|
SAINT-PIERRE
A DIJON
EN 2000
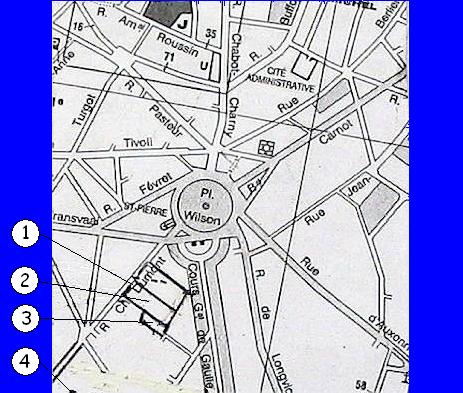
1.- Pharmacie André.
2.-
Cour du 13, rue Charles Dumont (1960)
3.- Mosquée de Dijon.
4.- le "Commodore".
|
|
Triple
division du terrain de la Pharmacie André,
plaçant la Mosquée de Dijon
dans le quartier de la Paroisse Saint-Pierre.
(Extrait
de plan de Dijon du calendrier des Postes 2000.)
|
|
Quelques
200 mètres en-dessous de la pharmacie, un immeuble a pour nom
le "Commodore" qui signifie commandeur,
ce qui, bien sûr, évoque la commanderie disparue et ses
occupants : c'est, comme par asar, pour lui, que les parents
de Y
quitteront la cour de la pharmacie...
|